ICRAKI
Hémodialyse intermittente versus épuration extra-rénale continue pour l'insuffisance rénale aiguë sévère des patients de réanimation
Vous êtes actuellement hospitalisé(e) dans un service de réanimation avec une défaillance respiratoire nécessitant (ou ayant nécessité) l’administration d’une ventilation mécanique et/ou une insuffisance circulatoire nécessitant (ou ayant nécessité) l’administration de médicaments (appelés catécholamines) pour améliorer l’efficacité de la circulation sanguine. La sévérité de la maladie qui a conduit à votre admission en réanimation est également responsable de la survenue d’une atteinte des reins que l’on appelle insuffisance rénale aiguë. L’insuffisance rénale aiguë se manifeste par une réduction très importante de la quantité d’urine émise chaque jour voire d’un arrêt total de la production d’urine. Cette incapacité des reins à assurer leur fonction normale engendre des accumulations potentiellement dangereuses de liquides, de déchets y compris des toxines dans le corps. L’accumulation de toxines dans l’organisme peut être responsable de divers symptômes affectant le système circulatoire ou le système nerveux. La guérison des reins se produit le plus souvent spontanément selon un délai de quelques jours à 3 semaines. En attendant que se produise la guérison rénale, la sévérité de l’atteinte actuelle de vos reins fait qu’il est nécessaire de recourir au rein artificiel. Cette nécessité est totalement indépendante de la recherche. Le rein artificiel est une machine qui vient remplacer transitoirement la fonction des reins. Cette machine prélève le sang par un tuyau (cathéter) placé dans une grosse veine de la cuisse ou du cou, le débarrasse de ses toxines grâce à une sorte de filtre et restitue le sang ainsi purifié à l’organisme par le même tuyau (ce tuyau possède un double canal). Plusieurs techniques de rein artificiel existent. Les plus fréquemment utilisées dans le monde sont l’hémodialyse intermittente et l’épuration continue. Elles reposent sur des mécanismes physiques différents mais qui permettent l’un et l’autre de corriger les anomalies résultant de l’arrêt de la fonction des reins. La correction des anomalies se fait plus rapidement avec l’hémodialyse intermittente qu’avec l’épuration continue ce qui explique que la durée des séances n’est pas la même avec ces deux techniques, ainsi qu’on l’explique plus loin. En France, plusieurs recherches ont montré que ces deux techniques étaient utilisées de façon égale. La différence majeure entre ces deux techniques est que l’hémodialyse intermittente nécessite un branchement sur la machine pour des séances d’une durée limitée (4 à 6 heures par jour). Ces séances sont répétées tous les jours ou tous les deux jours en fonction des besoins, et ce jusqu’à la récupération du fonctionnement des reins. De son côté, l’épuration continue consiste à l’utilisation de cette autre technique 24h sur 24 jusqu’à la récupération rénale. Chacune des deux techniques possède des avantages et des inconvénients parfaitement connus et qui semblent s’équilibrer. L’avantage de l’hémodialyse intermittente est qu’elle ne nécessite qu’un branchement sur la machine de quelques heures dans la journée. Son inconvénient est que parfois son efficacité plus rapide peut causer une baisse de la tension artérielle. Celle-ci est évidemment immédiatement prise en charge. L’avantage de l’épuration continue est qu’elle expose moins à ces baisses de tension. Par contre, elle oblige à un branchement sur la machine en permanence ce qui a deux conséquences : il est moins simple de commencer la rééducation précoce et il est nécessaire pour éviter que le sang ne bouche les tuyaux en coagulant d’utiliser des médicaments anticoagulants en continu ce qui peut générer des saignements qui sont pris en charge immédiatement. A ce jour, les études publiées comparant ces 2 techniques n’ont pas permis de démontrer la supériorité de l’une par rapport à l’autre. Ceci explique que ces 2 techniques soient couramment utilisées en réanimation, avec une fréquence à peu près identique. Néanmoins, ces études précédentes datent de plus de dix ans et comportaient des faiblesses méthodologiques qui ont empêché de pouvoir conclure définitivement quant à l’efficacité et aux risques comparés des deux techniques. De plus, la technologie et les soins de réanimation ont considérablement évolué depuis. Il est donc important de pouvoir enfin préciser laquelle des deux techniques est préférable, afin de faire progresser la qualité des soins apportés aux patients. La recherche proposée consiste donc à comparer ces deux techniques de rein artificiel. Cette étude permettra de préciser si une technique est supérieure à l’autre dans certaines indications. Si toutefois ces 2 techniques s’avéraient équivalentes, ce résultat permettrait d’orienter le choix d’un service de réanimation vers la technique la moins coûteuse pour la collectivité. Pour répondre à la question posée dans la recherche, il est prévu d’inclure 1000 personnes présentant une insuffisance rénale aiguë sévère nécessitant le recours au rein artificiel dans plusieurs services de réanimation Français.
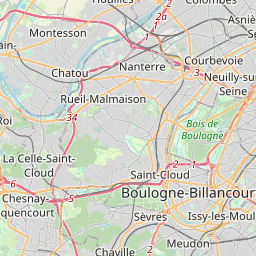
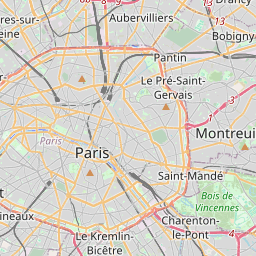
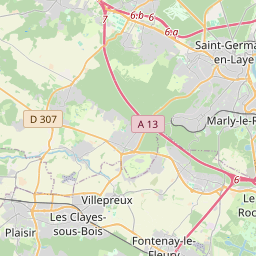
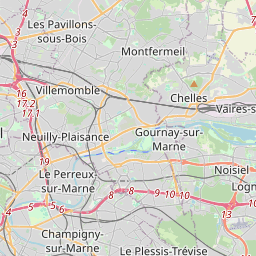
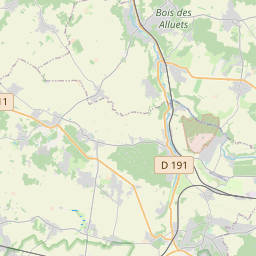
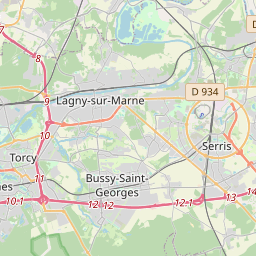


![[Esprit d'équipe] À la rencontre des agents de chambre mortuaire](https://i.ytimg.com/vi/_Xw3PM6AGaA/mqdefault.jpg)
